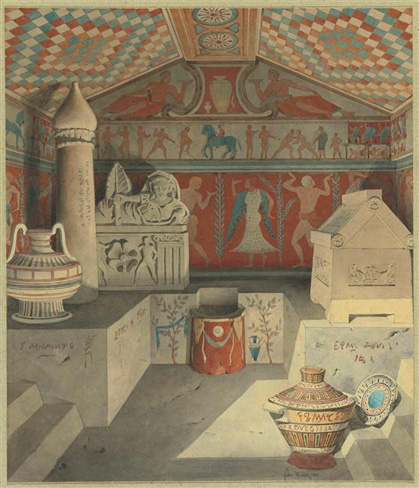Peintre anonyme, Elizabeth Ire, dit The Darnley Portrait, vers 1575 © National Portrait Gallery, Londres
Le musée du Luxembourg à Paris accueille depuis le 18 mars une des familles les plus rocambolesques de l’histoire de l’Angleterre: les Tudors. Comparé aux leurs, les scandales de la famille Windsor font pâle figure. Le danger était alors de succomber à la tentation de ce monde semi-historique peuplé d’Elizabeth la Reine Vierge, de Henri VIII Barbe Bleu et de Marie la Sanglante, le tout lorgnant vers le culte des séries télévisée comme Les Tudors ou Game of Thrones. Ce n’est pourtant pas une exposition dédiée aux « happy few », aux spécialistes de la Renaissance anglaise. Le musée du Luxembourg, en partenariat avec la National Portrait Gallery de Londres, organisatrice de l’exposition The Real Tudors: Kings and Queens Rediscovered achevée début mars, remet les choses simplement à leur place: au Seizième siècle.
Quelques réalités historiques, souvent occultées, sont ainsi rappelées au public, habitué à la surexposition aux images: il n’existe pas de portrait contemporain d’Anne Boleyn. Seule une petite médaille donne une idée de l’apparence physique de la femme pour laquelle Henri VIII a remué ciel et terre. La situation est comparable pour Jane Grey, la « reine de neuf jours »: aucun portrait contemporain à pu lui être attribué avec certitude. Ce n’est pas pour autant une succession de tableaux, de médailles et de chartes qui attendent le visiteur. L’ouverture au monde moderne et contemporaine est faite dès l’entrée. On est accueilli par un extrait de film de 1912, dans lequel Sarah Bernhardt incarne la reine Elizabeth Ier, fille d’Anne Boleyn, la seconde épouse d’Henri VIII. Dans une vitrine sur la gauche se trouve un manteau de sacre, le costume de cinéma porté par l’actrice Cate Blanchett dans le film « Elizabeth » (1998) écrit par Michael Hirst, l’auteur de la série télévisée à grand succès Les Tudors. Avant de passer au Seizième siècle, on aura reconnu en face la reine Anne Boleyn à la Tour de Londres, effondrée en pleurs, sur un tableau peint par Edouard Cibot en 1835 (musée Rolin, Autun). À droite sont le roi Henri VII, fondateur de la dynastie Tudor, et sa femme, Elizabeth d’York.
On entre ensuite dans l’espace qui présente la seconde génération des Tudors et ses contemporains français, de Louis XII à la famille de François Ier. Plusieurs portraits d’Henri VIII jeune, son armure porté au Camp du Drap d’Or près de Boulogne en 1520, des portraits des enfants de France et des chartes mettent en lumière les relations étroites entre les deux royaumes au début du 16e siècle. Une découverte est le portrait de Marie d’Angleterre par Michel Sittow, conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, longtemps présenté comme celui de Catherine d’Aragon, première épouse du roi d’Angleterre. En 1514, cette jeune sœur d’Henri VIII fut envoyé en France pour épouser Louis XII.
Au tournant, l’impressionnant portrait d’Henri VIII en pied, la copie anonyme d’une œuvre de Holbein venu de Petworth House, prend tout la place et impose la présence physique de ce géant, renforcée encore par des habits somptueux et hors de prix. Le roi est suivi de portraits de ses femmes et de ses enfants Marie Tudor et Edouard, ce fils tant désiré peint par Holbein en 1538, où le petit garçon d’environ un an tient son hochet comme un sceptre.
La pièce suivante est consacré à Elizabeth, second enfant d’Henri VIII. À la suite de sa demi-sœur Marie Tudor, elle deviendra reine d’Angleterre en 1558. De magnifiques portraits d’elle – le portrait Darnley (ci-dessus) et le fameux portrait au phénix –, des portraits de ses courtiers et quelques objets précieux, comme sa bague renfermant son portrait et celui de sa mère Anne Boleyn (vers 1575) montrent tout l’éventail de la cour d’Angleterre entre représentation et intimité. Sa grande rivale Marie Stuart rappelle l’histoire mouvementé entre l’Angleterre, l’Écosse et la France à partir du milieu du 16e siècle.
La dernière partie de l’exposition évoque la présence des Tudors au théâtre, commençant par Shakespeare, puis dans l’opéra et dans la littérature du 19e siècle. Ces œuvres de fiction ont durablement marqués les représentations de la famille Tudor, et quelque peu obstrués les faits historiques.
Une dernière remarque sans doute anachronique, et qui peut paraître saugrenue. Mais peut-être donnera-t-elle matière à réflexion sur une époque où la reine était une vierge, mais aussi le chef d’état et le chef de l’armée. J’ignore si la recherche sur le gender, c’est-à-dire le genre et sa définition voire sa confusion, a déjà remarqué un étrange échange de symboles de féminité et de masculinité exprimé par la mode.

Marcus Gheeraerts le Jeune, Robert Devereux, comte d’Essex, vers 1597 © National Portrait Gallery, Londres
Robert Devereux (1565-1601), comte d’Essex, porte sur ce portrait prêté par la National Portrait Gallery, les habits et le collier de l’Ordre de la Jarretière (en Anglais the Order of the Garter), le plus prestigieux des distinctions d’honneur de la chevalerie de Grande Bretagne, créé au 14e siècle. Le comte d’Essex était l’un des favoris d’Elizabeth Ier. Sa relation houleuse avec la reine est bien reconstitué dans Elizabeth I, un film de 2005 où la souveraine est incarnée par l’actrice britannique Hellen Mirren. Pour des yeux du 21e siècle, il est inhabituel de voir un homme portant ce qui ressemble à une robe. Si on revient maintenant sur le portrait dit Darnley d’Elizabeth Ier, elle y porte un pourpoint orné de broderies qui évoquent celles d’une uniforme de cavalier d’une époque bien plus récente. Ce détail curieux n’a d’ailleurs pas échappé à la National Portrait Gallery, qui décrit la reine « wearing a rather masculine doublet with a lace ruff collar » (« portant un pourpoint, un vêtement plutôt masculin »). Cette confusion visuelle entre les genres confirme à mon avis l’auto-identification d’Elizabeth Ier à une reine et un roi; elle est simultanément faible femme et chef suprême de l’armée d’Angleterre, une revendication d’ailleurs clairement exprimé quelques années plus tard dans son discours de Tilbury ou Armada speech de 1588.
Cette exposition au musée du Luxembourg me semble indispensable à toutes celles et tous ceux qui cherchent à dépasser la façade glamour et théâtrale de l’image des Tudors véhiculée par la télévision, le cinéma et par tout un courant de livres pseudo-historiques. En revanche, avec une série télévisée comme Wolf Hall, basée sur les livres de Hilary Mantel et encore et toujours consacré aux Tudors, la télévision s’approche peut-être d’avantage d’une certaine vérité historique.